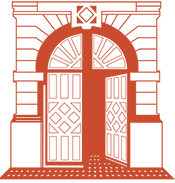Bienvenue au LRMH, clinique des monuments historiques
REPORTAGE. Depuis bientôt un demi-siècle, le Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH) est le bras scientifique de l’État pour la préservation de son patrimoine. A Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), 23 scientifiques sont au chevet des monuments soumis aux affres du temps comme aux catastrophes.
Établi dans les communs du château de Champs-sur-Marne, le LRMH a le statut de service à compétence nationale, venant au secours des édifices classés et inscrits au titre des monuments historiques. Il émet des préconisations sur les méthodes idoines pour la restauration et la préservation des différents matériaux et s’applique également à la recherche en tant qu’unité du CNRS.
« On a les reins solides »
Dans les couloirs où trônent d’anciennes appliques « Discipline », « Sacrifice » ou « Fraternité », se côtoient chimistes, physiciens, ingénieurs des matériaux et microbiologistes aux « reins solides », appuie Claudine Loisel, responsable du pôle scientifique Vitrail. Cette équipe de 23 scientifiques, sur une structure totale de 34 salariés, se répartit entre neuf pôles allant du bois à la pierre, en passant par les grottes ornées, le textile et le métal.
En 2018, cette brigade d’experts au service du patrimoine s’est rendue au chevet de 177 monuments historiques pour 298 opérations différentes à travers la France. Certaines se règlent « en une quinzaine de courriels », d’autres sur plusieurs années. En 2019, le volume d’interventions est resté presque identique, mais se trouve désormais impacté par l’urgence de Notre-Dame de Paris, sans effectif supplémentaire.

Littéralement, « Notre-Dame nous est tombée dessus », confie Thierry Zimmer, « mais il faut poursuivre tous les autres chantiers, et cela multiplie la charge de travail ». Le soir du 15 avril, alors que les flammes léchaient la toiture et la flèche de la cathédrale parisienne, le choc a été de courte durée. Tels des urgentistes, « il a fallu se mettre tout de suite en ordre de bataille, on ne réfléchit pas, il faut y aller », narre le directeur adjoint.
« C’est là que nous sommes complètement dans la mission du LRMH, accompagner dans ces catastrophes les acteurs de la restauration pour avoir les bons gestes, les bons réflexes, la bonne méthode de conservation », plaide quant à elle Claudine Loisel.

Faire parler les matériaux
Dans leur malheur, les scientifiques du LRMH attendent pourtant beaucoup des vestiges de Notre-Dame : « c’est horrible à dire, mais nous allons en savoir beaucoup plus sur Notre-Dame qu’on en savait jusqu’alors », nuance Thierry Zimmer. Dès le 17 avril, le laboratoire propose un protocole de tri des matériaux dans les décombres, en association avec les enquêteurs de la police scientifique.
Quand les uns tentent de faire parler les indices, les autres chercheront à faire parler les pierres tombées, les mortiers rétractés, les vitraux encroûtés et les bois carbonisés pour nourrir la documentation scientifique. Comme un parent de famille nombreuse, le LRMH ne peut se permettre de faire primer la cathédrale parisienne sur les autres édifices historiques qui ne mettront pas leur déliquescence en suspens.
Les éboulis de Notre-Dame de Paris ont pourtant fait leur place dans les étagères et rythment certains laboratoires. Dans l’atelier vitrail, Claudine Loisel se penche justement sur un panneau triangulaire provenant de l’écoinçon entre la nef et le chevet. Pour cette chimiste, l’élément est familier puisqu’elle avait entrepris dès 2014 une étude des vitraux du sanctuaire religieux dans l’optique de les restaurer : « on se préparait à sélectionner des équipes de restauration qualifiées », se souvient-elle, éblouie par sa table lumineuse.
Des vitraux du XIIIe siècle encore jamais observés
Méconnaissable sous son épaisse couche de suie, de poussières et de plomb, le panneau vitré ne pose pas vraiment d’inquiétudes à sa thérapeute. Après un délicat nettoyage au coton tige, le vitrail révèle timidement une touche de couleur. « Pour les vitraux du XIXe et du XXe siècle, on sait que le verre est résistant. Là où ce sera très intéressant, ce sont les vitraux du XIIIe siècle du côté de la Rose et au niveau des façades occidentale, sud et nord. Le protocole sera à revoir pour ces vitraux, on sera très prudents », diagnostique Claudine Loisel.

Si les vitraux sont sortis indemnes de l’incendie, c’est que les pompiers avaient interdiction d’y projeter leurs lances à eaux, « ce qu’ils ont réussi de manière majestueuse », félicite la responsable du pôle dédié. Une fin que n’ont pas connu certains mortiers et voûtains de la cathédrale. Leur analyse permettra néanmoins de déceler les techniques employées pour produire les enduits, leur porosité, et de tenter de déterminer le rôle qu’ils ont pu jouer au cours de l’incendie.
« En l’état, nous pensons que le plâtre a pu jouer un rôle de protection des pierres », estime Jean Ducasse-Lapeyrusse, ingénieur recruté par le Cercle des partenaires du patrimoine qui s’attelle également à analyser le temps de séchage d’une pierre extraite de Notre-Dame. Collectée le 24 avril, celle-ci repose emmaillotée dans un laboratoire. Selon son volume, « un séchage complet est estimé à 2 ans et demi, ce qui conditionne beaucoup la suite du chantier », prévient le chercheur en contrat.
Répertorier et anticiper
C’est également sur ce point qu’intervient le LRMH. Passés le coup de ciseaux sur le ruban inaugural, le retour à la normalité religieuse et aux flux touristiques, les scientifiques continueront de garder un œil sur l’édifice restauré et d’être attentifs aux réactions des différents matériaux. Pour Thierry Zimmer « il faudra préserver l’avenir », et anticiper par exemple « le temps de séchage si l’on a recours à des bois verts, comme cela était pratiqué au Moyen-Age ».
Ce chantier prévisionnel s’avère particulièrement vaste pour le pôle scientifique Pierre. Entre les rayonnages mobiles de la lithothèque qui conserve plus de 6.000 échantillons de pierres, la géologue Lise Leroux cherche ce jour-là une pierre de substitution à celles utilisées sur une partie du palais des Papes à Avignon. Cette question se posera également à Notre-Dame de Paris, pour la structure comme pour les sculptures endommagées, qui nécessitent des pierres calcaires « très fines et dures ».


« Il va falloir penser très rapidement à la substitution », alerte Lise Leroux, en pleine formation de cordiste pour approcher de plus près les voûtes de Notre-Dame. Avant de penser à l’ouverture de carrières, la géologue estime qu’il faut d’abord « établir un inventaire de la ressource disponible, connaître le projet architectural et ses besoins et prendre les décisions sur les pierres conservables et réemployables ».
Nettoyage au laser
Préserver ces matériaux est aussi pour Claudine Loisel, « une manière de se montrer dignes des bâtisseurs qui ont édifié la cathédrale ». Depuis l’incendie, de nombreux blocs de Notre-Dame de Paris et deux des angelots de la croisée du transept sont entreposés dans l’arrière-cour du LRMH. Juchés sur une mezzanine en bois, la responsable du pôle Pierre Véronique Vergès-Belmin et ses deux collègues expérimentent le nettoyage d’une pierre au laser.
L’énergie produite par le rayon laser d’un point de vue thermique et mécanique permet de retirer un siècle de « croûtes noires ». Pour Véronique Vergès-Belmin, auteure de nombreux textes sur ce protocole, la méthode a déjà fait ses preuves, et évite le recours à une projection d’eau ou d’usage de solvants. Si elle s’avère tout aussi fructueuse pour les pierres de Notre-Dame de Paris, elle ferait l’objet de préconisations pour les restaurateurs.


Dans tout ce bouillonnement scientifique autour des pathologies de Notre-Dame, comme d’autres monuments – du château de Lunéville aux grottes de Lascaux – « c’est bien la science qui est au service du patrimoine et pas le patrimoine au service de la science », opine Claudine Loisel.